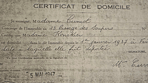Chapitre 10 : Pas envie d'écrire mais c'est ce que je suis en train de faire
Bienvenue. Ici, nous sommes dans une autofiction. Il sera question de mon arrière grand-mère (maternelle). De tout ce que l'on sait sur elle. De tout ce que l'on ne sait pas. De tout ce que l'on s'apprête à découvrir. Parfois, j'inventerai pour combler les trous de notre mémoire/histoire familiale (sans travestir la réalité historique).


Je n’ai pas envie de l’écrire, la newsletter de cette semaine. Je vais quand même le faire. D’ailleurs, c’est ce que je suis en train de faire.
Qu’écrire ?
Qu’il y a 80 ans pile, Chana Konskier et d’autres Juifs polonais ont été arrêtés à Paris. Le 4 février 1944 a eu lieu la dernière rafle exécutée par la préfecture de police.
De cet événement, je ne souhaite pas parler. Pas plus.
Je laisse donc la parole aux historiens : La police parisienne, pour éviter d’arrêter des Juifs français, cible les Juifs étrangers, les derniers Juifs polonais recensés. 525 personnes sont arrêtées, 481 sont internées à Drancy et 459 sont déportées.
J’ai appris ça, cette date, cette rafle, cette année, je ne le savais pas avant. Je n’avais jamais vraiment cherché.
Je ne cesse de le répéter : ici, se retrouve le récit d’une vie. Le reste, pas ici.
Qu’écrire ?
Le dernier jour d’une vie au 13 passage des Soupirs ?
Ça ne vient pas : les mots ne s’enfilent pas, pas comme des perles. Pas de collier, pour aujourd’hui.
Mettons-nous d’accord sur une chose : Chana ne savait pas qu’elle serait arrêtée. Avec les connaissances que l’on a aujourd’hui, je ne parviens pas à comprendre : comment a-t-elle pu rester dans la gueule du loup ?
Comme tous les autres jours, Chana a passé la journée à faire des choses. Liste des certitudes : se lever, s’habiller, se nourrir. Liste des incertitudes : s’étirer, se préparer un thé qu’on ne boira pas, se regarder dans un miroir, repasser sa blouse, aller chez la boulangère, échanger des banalités avec sa voisine dans la queue, commander une baguette, avoir droit à une demie, coudre, terminer le pantalon de Monsieur Seguin, penser à la chèvre de Monsieur Seguin sans connaître la morale de l’histoire, rentrer chez soi, vider ses poches, déposer le bazar sur la commode, se remettre à la machine à coudre. Entendre la porte cogner. Une porte, ça ne cogne pas.
*
80 ans plus tard, je traîne passage des Soupirs. Emmitouflée sous d’épaisses couches de couleurs, j’attends que la porte s’ouvre. Je la fixe. Je détache mon regard du bleu de la porte quelques secondes. Je reviens pour contempler sa poignée, si fragile, prête à perdre l’équilibre. Rien ne se passe : la poignée tient toujours en place. Je me déplace. Je croise le regard d’un homme de plus de 80 ans, je m’approche de lui et je lui demande : “vous connaissez des gens au numéro 13 ?”
Non, il ne connaît personne dans cet immeuble. Mais, il écrit un livre sur l’histoire du 20ème arrondissement. Il est à la retraite et a décidé d’entretenir ses capacités cérébrales grâce à l’étude de l’histoire. La méthode semble faire ses preuves. Sans attendre sa curiosité, je lui expose mon projet : retrouver mon arrière-grand-mère, enfin, retracer son histoire, enfin, sortir du vide.
La porte s’ouvre, il s’enthousiasme, ou le contraire, il s’enthousiasme, la porte s’ouvre. Je me précipite. J’explique au couple qui sort ce que je suis, ce que je veux. Je veux visiter l’appartement dans lequel mon arrière-grand-mère vivait. Mes interlocuteurs se méfient et me conseillent de sonner chez les gens du premier étage, ils m’indiquent un nom sur l’interphone. “Bonjour, je suis désolée, ma démarche peut sembler intrusive, mais mon arrière-grand-mère vivait là, j’écris un récit sur son histoire, est-ce que je peux rentrer pour visiter ?”
J’entre. Je reste béate : la cour dévoile un autre immeuble, un immeuble sur cour. Une femme penchée à la fenêtre m’invite à monter. J’accepte. Elle et son mari viennent de rentrer de vacances, leurs valises éventrées en guise de preuves. Je leur explique : mon arrière-grand-mère vivait en face. Pas ici, pas chez vous.
“Vous voulez les plans de l’immeuble ? Et les rapports de copropriété ?”
Oui et oui. Je veux tout. Je veux essayer de comprendre qui étaient ses voisins pour essayer de dessiner les contours de son existence.
“Vous voulez un thé ou un café ?”
Je rougis : je viens de réaliser que je suis assise sur le canapé de personnes que je ne connais pas qui m’ouvrent leur porte parce qu’elles sont sensibles à mon histoire.
Les mercis s’organisent en file indienne : merci, merci, merci beaucoup.
“Je viens de penser, on organise une galette des rois entre habitants du quartier dans le jardin d’en face. Peut-être que vous pourrez poser des questions aux anciens, vous voulez venir ?”
Oui. Merci, merci, merci beaucoup.
Il fait un froid de loup dans le jardin. Je ne l’imaginais pas si touffu, si profond. Je ne l’imaginais pas tout court, j’étais concentrée sur la porte bleue, sa peinture qui s’effrite, sa boîte aux lettres trop basse. Nos souffles dégagent un brouillard tranquille. Je salue tout le monde. On me propose un bout de galette, comme si ma présence ici était normale, dans le sens des choses.
“On ne s’est pas vus depuis quand ?”
“Comment vont les enfants ?”
“Jus d’orange ou jus de pomme ?”
“L’année du bac, déjà ?!”
“Et alors ta reconversion, comment ça se passe ?”
Le couple qui m’avait accueillie me présente la doyenne du quartier : Fleurette.
Yeux bleus, paupières grises irisées, voix chaude, nuque déployée, tenue imposant le respect.
Fleurette, 98 ans.
Très vite, le point Godwin de la conversation nous ébranle toutes les deux.
Ses parents, originaires de Varsovie, se sont installés rue de Charonne dans les années 30.
D’un revers de main, elle me signifie qu’elle ne veut pas s’attarder sur le sujet.
Elle préfère me faire le récit de Mai 68, “seules les femmes enceintes et les jeunes qui partaient à l’armée pouvaient passer leur examens. Moi, je ne faisais partie d’aucune de ces deux catégories, mais je ne pouvais pas attendre, non, je ne pouvais pas. J’ai écrit une lettre déchirante. Et, j’ai obtenu l’autorisation de composer, l’année d’après, j’enseignais l’anglais.”
...